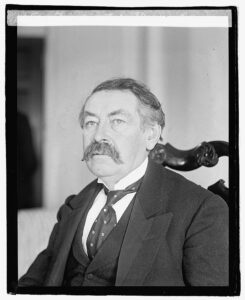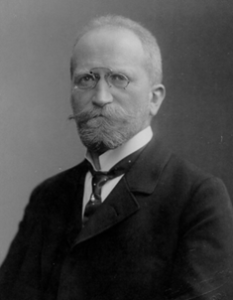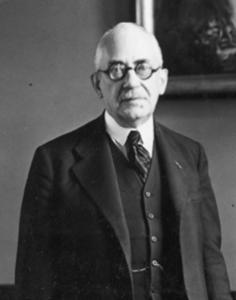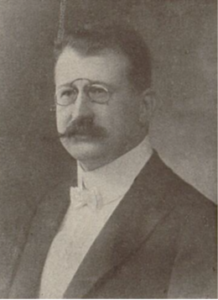Personnalités éminentes qui (outre le Dr. Elemér Hantos) ont apporté une contribution majeure à la promotion de la coopération économique dans le monde:
Pál Auer (1885-1978), avocat, homme politique et diplomate hongrois.
Après des études de droit à l'Université de Budapest et des séjours à Vienne, Berlin, Paris et Londres, Pál Auer réussit l'examen du barreau en 1911. Il ouvre ensuite son cabinet à Budapest et se spécialise en droit international. Après l'effondrement de l'Autriche-Hongrie à la fin de la Première Guerre mondiale, Pál Auer devient membre du Conseil national de Mihály Károly. Après une période d'instabilité politique en Hongrie, durant laquelle il réside à Vienne, Auer retourne à Budapest. En 1921, il est nommé conseiller juridique de la légation française en Hongrie. À ce titre, il participe « discrètement à l'évolution des relations officielles franco-hongroises » dans les années 1920 et 1930.
Durant l'entre-deux-guerres, Pál Auer participe aux activités de l'Union paneuropéenne, présidée par le comte Richard Coudenhove-Kalergi. À partir de 1930, il est le président de la section hongroise de l'Union paneuropéenne. Comme Elemér Hantos, Auer est favorable à un approfondissement de la coopération économique et politique entre les États successeurs de l'Autriche-Hongrie. C'est pour cette raison qu'il organise une conférence danubienne à Budapest en février 1932.
À la suite de cette conférence, il préside le Comité pour le rapprochement économique des pays danubiens. Pour lui, une « confédération danubienne » est particulièrement importante pour empêcher l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Après la Seconde Guerre mondiale, Pál Auer devint député au Parlement hongrois et président de sa commission des affaires étrangères. En mars 1946, Auer fut nommé chef de la légation hongroise à Paris. Après la prise du pouvoir par les communistes en 1947, Auer est "[contraint] à choisir l'exil" et reste à Paris, où il demeure un "médiateur entre l'Europe mediane et la France". Auer est également très actif au sein du Mouvement européen, initié par Winston Churchill. Jusqu'à sa mort, il défend le concept de « confédération danubienne ».
Cliquez ici pour voir (en anglais) le crédit de l'auteur, les sources et le crédit photo.
Aristide Briand (1862-1932), avocat, journaliste, homme politique français, lauréat du prix Nobel de la paix.
Après des études de droit à l'Université de Paris, Aristide Briand débute sa carrière professionnelle comme avocat et journaliste. En 1902, il devient député à la Chambre basse du Parlement français. Après avoir défendu avec succès la loi de séparation des Églises et de l'État en 1906, il est ministre dans différents gouvernements et est également nommé Premier ministre à plusieurs reprises avant et pendant la Première Guerre mondiale.
En septembre 1929, Aristide Briand annonce sa volonté de créer « une sorte de lien fédéral » entre les peuples européens dans un discours adressé à l’Assemblée générale de la Société des Nations. Elemér Hantos estime que « c’est l’idée de l’unité économique de l’Europe et non point celle d’une Pan-Europe politique qui ressort des discours de Briand ». C’est pour cette raison que Hantos est déçu lorsque le mémorandum de Briand, présenté en mai 1930, consacre la primauté de la politique sur l’économie.
Après l'annonce du projet d’union douanière austro-allemande en mars 1931, qui marque un tournant dans la politique étrangère allemande, Aristide Briand présente en septembre 1931 à la Commission d’études pour l’Union européenne de la Société des Nations le mémorandum d’Elemér Hantos sur la réorganisation économique de l’Europe centrale.
Cliquez ici pour voir (en anglais) le crédit de l'auteur, les sources et le crédit photo, et ici pour la biographie sur Wikipédia.
Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1972), philosophe et homme politique autrichien.
Après avoir obtenu son doctorat en philosophie à l'Université de Vienne en 1917, Richard Coudenhove-Kalergi développa son idée paneuropéenne dans plusieurs articles de journaux et de revues. Dans son ouvrage programmatique Pan-Europa, publié à Vienne en 1923, Coudenhove-Kalergi appelait à l'unification politique et économique des États européens, à l'exception de la Turquie, de l'Empire britannique et de la Russie soviétique. Dans le volet économique de son programme, il préconisait la création d'un espace économique paneuropéen en supprimant toutes les barrières économiques, douanières et de transport entre les États européens. Coudenhove-Kalergi considérait que l'unification économique de l'Europe ne pouvait se réaliser que progressivement. Dans ce sens, il envisageait la formation d'alliances économiques, douanières et monétaires entre plusieurs pays, tels que les États successeurs de l'Autriche-Hongrie, qu'il mentionnait expressément dans son ouvrage programmatique, comme une première étape vers une Union économique paneuropéenne.
Pour promouvoir son idée paneuropéenne, Richard Coudenhove-Kalergi fonda à Vienne l'Union Paneuropéenne, qui comptait des sections nationales et locales dans toute l'Europe, publia de nombreux articles, négocia avec les dirigeants politiques et organisa régulièrement des conférences et congrès paneuropéens. Après l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie, Coudenhove-Kalergi s'exila à Paris, puis à New York. Après la Seconde Guerre mondiale, il inspira le célèbre « discours de Zurich » de Winston Churchill et participa au Mouvement européen. Pour son engagement de plus de vingt-cinq ans en faveur de l'unification politique et économique de l'Europe, Coudenhove-Kalergi reçut le premier prix international Charlemagne de la ville d'Aix-la-Chapelle en 1950.
Cliquez ici pour voir (en anglais) le crédit de l'auteur, les sources et le crédit photo, et ici pour la biographie sur Wikipédia.
Georg Gothein (1857-1940), ingénieur, homme politique et économiste allemand.
Après des études à l'Université de Breslau (aujourd'hui Wrocław) et à l'Académie des Mines de Prusse à Berlin, Georg Gothein débuta sa carrière comme officier des mines en Silésie, puis travailla comme conseiller juridique à la Chambre de commerce de Breslau. Grâce à ses compétences exceptionnelles, toujours mises à profit dans un esprit de libéralisme et de libre-échange, Gothein entra à la Chambre des représentants de Prusse en 1893 et à l'Assemblée impériale allemande en 1901. Après la Première Guerre mondiale, il fut non seulement député à l'Assemblée nationale allemande jusqu'en 1924, mais aussi brièvement ministre sans portefeuille et ministre des Finances en 1919, avant de quitter le gouvernement allemand après la ratification du traité de Versailles.
En tant que défenseur du libre-échange, Georg Gothein participa aux activités de l'Association allemande pour l'accord commercial et de la Ligue allemande de libre-échange, fondée en novembre 1921, et présida le « Groupe allemand » du Congrès économique d'Europe centrale de 1926 à 1930. À ce titre, il critiquait le projet centre-européen d'Elemér Hantos, qui prônait un rapprochement économique entre les États successeurs de l'Autriche-Hongrie, car il excluait l'Allemagne. Gothein était un fervent défenseur du rattachement économique de l'Autriche à l'Allemagne, qu'il considérait comme la seule voie possible vers la réalisation d'une « Grande Europe centrale » ou d'une pan-Europe économique. Hantos s'opposait au rattachement économique et politique de l'Autriche à l'Allemagne, car il craignait la prédominance économique et politique de l'Allemagne et souhaitait que les États successeurs puissent négocier sur un pied d'égalité.
Cliquez ici pour voir (en anglais) le crédit de l'auteur, les sources et le crédit photo, et ici pour la biographie sur Wikipédia.
Gusztáv Gratz (1875-1944), journaliste, économiste, homme politique et diplomate hongrois.
Après avoir obtenu son doctorat en sciences politiques à l'Université de Budapest en 1898, Gusztáv Gratz débuta sa carrière de journaliste. Plus tard, en 1906, il devint député au Parlement hongrois en tant que représentant des Saxons de Transylvanie.
En 1912, Gratz devint directeur général de l'Association hongroise des industriels. Pendant la Première Guerre mondiale, il fut particulièrement actif au sein du mouvement centre-européen, qui promouvait l'idée d'un rapprochement économique entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Il cherchait une formule « qui assurerait une certaine protection à l'industrie hongroise au sein de l'alliance économique [germano-austro-hongroise] ». En 1917, il fut nommé chef de la section du commerce extérieur du ministère des Affaires étrangères austro-hongrois à Vienne. Après un changement de gouvernement en Hongrie, il fut brièvement ministre des Finances, avant de reprendre ses fonctions au ministère des Affaires étrangères. De 1917 à 1918, il participa non seulement aux négociations économiques avec l'Allemagne sur une union économique centre-européenne, mais aussi aux négociations de paix de Brest-Litovsk et de Bucarest.
Après l'effondrement de l'Autriche-Hongrie et l'instabilité politique qui suivit la Première Guerre mondiale, Gusztáv Gratz fut nommé ambassadeur de Hongrie à Vienne, avant de devenir ministre des Affaires étrangères hongrois en janvier 1921. À ce titre, Gratz envisagea une coopération économique et politique entre les États successeurs de l'Autriche-Hongrie afin de stabiliser la région au sein du nouvel ordre international. Après avoir soutenu les deux tentatives infructueuses de restauration de l'ancien roi de Hongrie Charles, Gratz fut écarté de la politique hongroise. En 1926, il réintégra le Parlement hongrois en tant que représentant de la minorité allemande de Hongrie.
À partir de 1925, Gusztáv Gratz fut rédacteur en chef de l'Annuaire économique hongrois, qui présentait un aperçu de la situation économique de la Hongrie après la désintégration de l'espace économique austro-hongrois. Comme Elemér Hantos, Gratz prônait un rapprochement économique entre les États successeurs de l'Autriche-Hongrie comme première étape vers une Union économique et douanière européenne et participa aux activités du Congrès économique centre-européen et de l'Union paneuropéenne. À partir de 1930, il présida l'Institut centre-européen de Budapest, fondé par Elemér Hantos.
Cliquez ici pour voir (en anglais) le crédit de l'auteur, les sources et le crédit photo, et ici pour la biographie sur Wikipédia.
Milan Hodža (1878-1944), journaliste, historien et homme politique slovaque.
Après des études de droit à Kolozsvár (aujourd'hui Cluj-Napoca) et à Budapest, Milan Hodža débute sa carrière professionnelle comme journaliste. En 1905, il est élu député au Parlement hongrois à Budapest, représentant les Slovaques et les Serbes de la région du Banat. Durant son mandat, Hodža prône la coopération entre les Slovaques et les Tchèques et crée le « Club des nationalités », qui regroupe des députés slovaques, serbes et roumains. À cette époque, il est également membre du « Cercle du Belvédère » de l'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône, et œuvre à la transformation de la monarchie des Habsbourg en une fédération d'États-nations. Pendant la Première Guerre mondiale, il obtient son doctorat en philosophie à l'Université de Vienne.
Après l'effondrement de l'Autriche-Hongrie, Milan Hodža participa à la création du nouvel État tchécoslovaque et devint représentant du gouvernement tchécoslovaque à Budapest. À partir de 1920, il fut député du Parti agraire à la Chambre des députés du Parlement tchécoslovaque. En 1921, il fut également nommé professeur d'histoire à l'Université de Bratislava. Durant l'entre-deux-guerres, il fut ministre à plusieurs reprises : ministre de l'Agriculture de 1922 à 1926 et de 1932 à 1935, ainsi que ministre de l'Éducation de 1926 à 1929.
En tant que ministre de l'Agriculture, Milan Hodža souhaitait résoudre la crise agricole d'Europe centrale en favorisant la coopération économique entre les États successeurs de l'Autriche-Hongrie. Après l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, Hodža fut un fervent défenseur du rapprochement économique entre les États danubiens, conformément aux idées d'Elemér Hantos. Président du gouvernement tchécoslovaque à partir de novembre 1935, avec le portefeuille des Affaires étrangères, il s'efforça, en vain, de parvenir à un accord avec les autres États successeurs de l'Autriche-Hongrie.
Après les accords de Munich en septembre 1938, son gouvernement étant contraint à la démission, Milan Hodža s'exile en Suisse, puis en France et au Royaume-Uni, et enfin aux États-Unis, où il publie son célèbre livre Federation in Central Europe: Reflections and reminiscences en 1942.
Cliquez ici pour voir (en anglais) le crédit de l'auteur, les sources et le crédit photo, et ici pour la biographie sur Wikipédia.
Rudolf Hotowetz (1865-1945), économiste et homme politique tchèque.
Quelques années après l'obtention de son doctorat en droit à l'Université tchèque de Prague, Rudolf Hotowetz commença à travailler à la Chambre de commerce de Prague, « où il gravit progressivement les échelons jusqu'au poste de secrétaire général » et contribua grandement à son excellente réputation. En 1917, après des années de préparation, il fut nommé président du nouvel Institut général des pensions.
Après l'effondrement de l'Autriche-Hongrie et la création de la Tchécoslovaquie, Rudolf Hotowetz devint président du ministère du Commerce extérieur, puis ministre du Commerce. Hotowetz dut « faire face aux graves difficultés résultant de la séparation de la Tchécoslovaquie de l'ancienne unité économique ». Avec son collègue Václav Schuster, il fut responsable de « la définition des grandes lignes de la politique commerciale [tchécoslovaque] et de la conclusion des premiers et plus importants traités commerciaux » du nouvel État tchécoslovaque. En septembre 1921, Hotowetz démissionna de son poste de ministre du Commerce pour exprimer son opposition aux nouveaux tarifs votés par l'Assemblée nationale.
Dès lors, Rudolf Hotowetz prôna le rapprochement économique entre la Tchécoslovaquie et les autres États successeurs. Il favorisa également l'unification économique de l'Europe. Contrairement à Richard Coudenhove-Kalergi, chef du mouvement paneuropéen, Hotowetz considérait que la Russie soviétique devait être intégrée à l'espace économique européen. Avec l'homme d'affaires autrichien Julius Meinl et l'économiste hongrois Elemér Hantos, Hotowetz fut l'un des initiateurs du premier Congrès d'Europe centrale à Vienne en septembre 1925. Il fut également vice-président du Comité tchécoslovaque pour la coopération centre-européenne et président de la section tchécoslovaque de l'Union douanière européenne.
Cliquez ici pour voir (en anglais) le crédit de l'auteur, les sources et le crédit photo.
Walter Lippmann (1889-1974), journaliste américain, philosophe public et lauréat du prix Pulitzer.
Après des études à l’Université Harvard, Walter Lippmann entame une carrière de journaliste. En novembre 1914, il est l’un des rédacteurs fondateurs de la « New Republic », où il prône la fin de l’isolationnisme américain. À la fin de la Première Guerre mondiale, Lippmann est « invité à rejoindre l’équipe de l’« Inquiry », un organisme non-gouvernemental et largement clandestin créé […] pour élaborer les conditions de paix américaines ». En tant que secrétaire général, il participe à la rédaction du célèbre programme des « Quatorze Points » de Woodrow Wilson. Après la Première Guerre mondiale, Lippmann participe à la Conférence de paix de Paris en tant que membre de la délégation américaine. De retour aux États-Unis d’Amérique, il s’oppose à la ratification du traité de Versailles qui constitue, « pour lui, comme pour beaucoup d’autres », tel que l’économiste britannique John Maynard Keynes, qu’il a rencontré à Paris, « une expérience décevante ».
Durant l’entre-deux-guerres, Walter Lippmann devient l’un des journalistes et chroniqueurs les plus influents, écrivant pour le « World » et le « Herald Tribune » à New York, ainsi qu’un philosophe public reconnu. À la suite de la Conférence économique internationale de Londres en juin-juillet 1933, Lippmann commence à travailler sur le libéralisme. Ses recherches aboutissent à la publication de « La cité libre » en 1937, qui jette les bases du célèbre « Colloque Lippmann », marquant le renouveau de la pensée libérale. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il exprime son soutien au plan Marshall pour la reconstruction économique de l’Europe.
Cliquez ici pour voir (en anglais) le crédit de l'auteur, les sources et le crédit photo, et ici pour la biographie sur Wikipédia.
Julius Meinl II. (1869-1944), homme d'affaires autrichien.
Après des études à l'École de commerce de Vienne et un bref séjour à Londres, Julius Meinl commença à travailler pour l'entreprise agroalimentaire de son père. En 1913, après le départ à la retraite de son père, Meinl reprit l'entreprise, qui continua de se développer sous sa direction, malgré les nombreuses difficultés économiques et politiques de l'époque.
Pendant la Première Guerre mondiale, Meinl fonda la Société politique autrichienne avec l'industriel autrichien Max Friedmann. Cette société réunissait hommes d'affaires, professeurs et hommes politiques pour discuter de questions politiques et économiques. Avec les deux juristes et hommes politiques autrichiens Heinrich Lammasch et Josef Redlich, il participa aux pourparlers de paix avec les représentants des États-Unis d'Amérique en 1917-1918.
Après la Première Guerre mondiale, l'entreprise de Julius Meinl subit les conséquences de la désintégration de l'espace économique austro-hongrois. C'est pourquoi il prôna le rétablissement du libre-échange au sein des États successeurs. En 1924, il fonda la Ligue autrichienne de libre-échange pour lutter contre la nouvelle hausse des droits de douane prévue par le gouvernement autrichien. À ce titre, il invita d'autres défenseurs du libre-échange, tels que Václav Schuster, Elemér Hantos et Rudolf Hotowetz, à donner des conférences. Ensemble, ils organisèrent le premier Congrès économique d'Europe centrale à Vienne en septembre 1925, dans le but d'œuvrer à un rapprochement économique entre les États successeurs de l'Autriche-Hongrie.
Cliquez ici pour voir (en anglais) le crédit de l'auteur, les sources et le crédit photo, et ici pour la biographie sur Wikipédia (en allemand).
Ludwig Mises (1881-1973), économiste autrichien.
Après avoir obtenu son doctorat en droit à l’Université de Vienne, où il a étudié l’économie, Ludwig Mises entre au service de la Chambre de commerce de Vienne en 1909. Avant la Première Guerre mondiale, Mises obtient son habilitation en économie et commence à enseigner à l’Université de Vienne, où il devient professeur en 1918.
En septembre 1925, Ludwig Mises participe au premier Congrès économique de l’Europe centrale. À partir de 1928, il est également membre du Comité international de l’Union douanière européenne. Après la publication d’un ouvrage d’Elemér Hantos, dans lequel il présente l’unification économique des États successeurs de l’Autriche-Hongrie comme la première étape vers une union douanière et économique européenne, Mises démissionne en mars 1929, jugeant impossible de participer à des organisations opposées au rattachement économique de l’Autriche à l’Allemagne. Cependant, après la montée du national-socialisme en Allemagne, il participe aux Conférences économiques paneuropéennes organisées par le comte Richard Coudenhove-Kalergi.
En 1934, Ludwig Mises est invité par William Rappard à occuper un poste de professeur invité à l’Institut universitaire de hautes études internationales de Genève. En 1940, il émigre à New York, où il poursuit ses travaux scientifiques pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Ludwig Mises est connu comme l’un des « principaux représentants » du libéralisme économique.
Cliquez ici pour voir (en anglais) le crédit de l'auteur, les sources et le crédit photo, et ici pour la biographie sur Wikipédia.
Jean Monnet (1880-1979), homme d'affaires, fonctionnaire international et homme politique français.
Jean Monnet quitte le lycée avant d’obtenir son baccalauréat pour travailler dans l’entreprise familiale de cognac, pour laquelle il parcourt le monde. Pendant la Première Guerre mondiale, Monnet participe à l’organisation de l’économie de guerre, plus particulièrement à la coordination des approvisionnements franco-britanniques à Londres.
Au lendemain de la guerre, Monnet est nommé secrétaire général adjoint de la Société des Nations. À ce titre, il organise la Conférence financière internationale qui se tient à Bruxelles en septembre 1920. Il participe également à plusieurs missions de la Société des Nations, avant de démissionner en décembre 1922 pour œuvrer à la réorganisation de l’entreprise familiale de cognac en difficulté. À partir de 1926, Monnet entame une carrière de banquier international.
De retour en France à l’aube de la Seconde Guerre mondiale, Monnet participe à la préparation et à la coordination de l’effort d’armement franco-britannique et transatlantique. Après l’entrée des troupes allemandes à Paris en juin 1940, il soutient le projet d’Union franco-britannique. Après la défaite de la France, Monnet est envoyé aux États-Unis par le gouvernement britannique pour négocier l’achat de matériel de guerre et contribuer à la coordination de l’effort de guerre.
Après l’intervention alliée en Afrique du Nord française en novembre 1942, Monnet participe aux négociations qui aboutissent à la création du Comité français de libération nationale. À Alger en 1943, il commence à réfléchir à l’unification européenne d’après-guerre. Commissaire au Plan après la Seconde Guerre mondiale, Jean Monnet supervise la reconstruction économique de la France. Il œuvre « dans l'ombre » à l’unification économique de l’Europe et rédige la célèbre « déclaration Schuman », présentée le 9 mai 1950, considérée comme le point de départ de la « construction européenne ».
Lors des négociations sur le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), Jean Monnet propose la création de la Communauté européenne de défense (CED) au président français du Conseil René Pleven. Après l’entrée en vigueur du traité de Paris en juillet 1952, Monnet devient le premier président de la Haute Autorité de la CECA. Le traité instituant la CED est signé à Paris en mai 1952 par les gouvernements des six États membres fondateurs de la CECA mais l’initiative de Monnet échoue en août 1954, car l’Assemblée nationale française ne ratifie pas le traité.
Après sa démission, Monnet crée son Comité d’action pour les États-Unis d’Europe, afin de participer à la création de conditions favorables à une intégration économique européenne plus approfondie. Avec son comité, Monnet milite en faveur d’une communauté de l’énergie nucléaire et d’un marché unique lors de la « relance » européenne menée par les gouvernements néerlandais et belge à partir de 1955. Cette « relance » aboutit à la signature des traités de Rome en mars 1957, instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique.
Cliquez ici pour voir (en anglais) le crédit de l'auteur, les sources et le crédit photo, et ici pour la biographie sur Wikipédia.
William Rappard (1883-1958), historien, économiste et fonctionnaire international suisse.
Après avoir obtenu son doctorat en droit à l'Université de Genève, il débuta sa carrière professionnelle en 1909 comme secrétaire à l'Organisation internationale du Travail, basée à Bâle. Après quelques années d'enseignement, il fut nommé professeur à l'Université de Genève en 1913, dont il occupa également le poste de recteur de 1926 à 1928 et de 1936 à 1938. En 1928, il fonda l'Institut universitaire de hautes études internationales de Genève, qu'il dirigea jusqu'en 1955. De 1920 à 1925, Rappard travailla également pour la Société des Nations.
Tout au long des années 1930, William Rappard « dénonça la menace que représentait le nationalisme politique et économique pour la paix » et prôna une Europe unie. En tant que directeur de l'Institut de hautes études internationales et du développement, il invita Elemér Hantos à donner une série de conférences sur l'Europe centrale en 1930.
Cliquez ici pour voir (en anglais) le crédit de l'auteur, les sources et le crédit photo, et ici pour la biographie sur Wikipédia.
Václav Schuster (1871-1944), économiste, homme politique, diplomate et banquier tchèque.
Après avoir obtenu son doctorat en droit à l'Université tchèque de Prague, Václav Schuster entre au service de la Chambre de commerce de České Budějovice, avant de commencer à travailler à la Chambre de commerce de Prague, où il succède à Rudolf Hotowetz comme secrétaire général en 1917.
Après l'effondrement de l'Autriche-Hongrie et la création de l'État tchécoslovaque, Václav Schuster devint secrétaire d'État au ministère du Commerce et participa plus tard, en tant qu'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, aux négociations commerciales avec les grandes puissances et les autres États successeurs. À ce titre, Schuster contribua grandement à l'élaboration de la politique commerciale tchécoslovaque. Pour un journaliste du journal allemand Prager Presse, soutenu par le gouvernement tchécoslovaque, « il restera dans les mémoires pour son opposition lucide et courageuse au radicalisme naissant de la politique commerciale, même au risque de voir son patriotisme [tchèque] remis en question ». À partir de 1922, Schuster fut président d'une banque tchèque et membre des conseils d'administration de nombreuses entreprises privées, institutions publiques et associations.
« Avec un œil attentif », Václav Schuster a reconnu « plus tôt que quiconque l’importance pratique des mouvements d’unification [économique] […] lorsque cet objectif semblait encore être une utopie nébuleuse ».
Comme Elemér Hantos, Schuster prônait un rapprochement économique entre les États successeurs de l'Autriche-Hongrie, premier pas vers l'unification économique de l'ensemble du continent européen. Il fut président de la section tchécoslovaque de l'Union paneuropéenne et participa également aux activités du Comité tchécoslovaque de coopération économique centre-européenne, de la section tchécoslovaque de l'Union douanière européenne et de l'Institut d'Europe centrale de Brno.
Cliquez ici pour voir (en anglais) le crédit de l'auteur, les sources et le crédit photo.